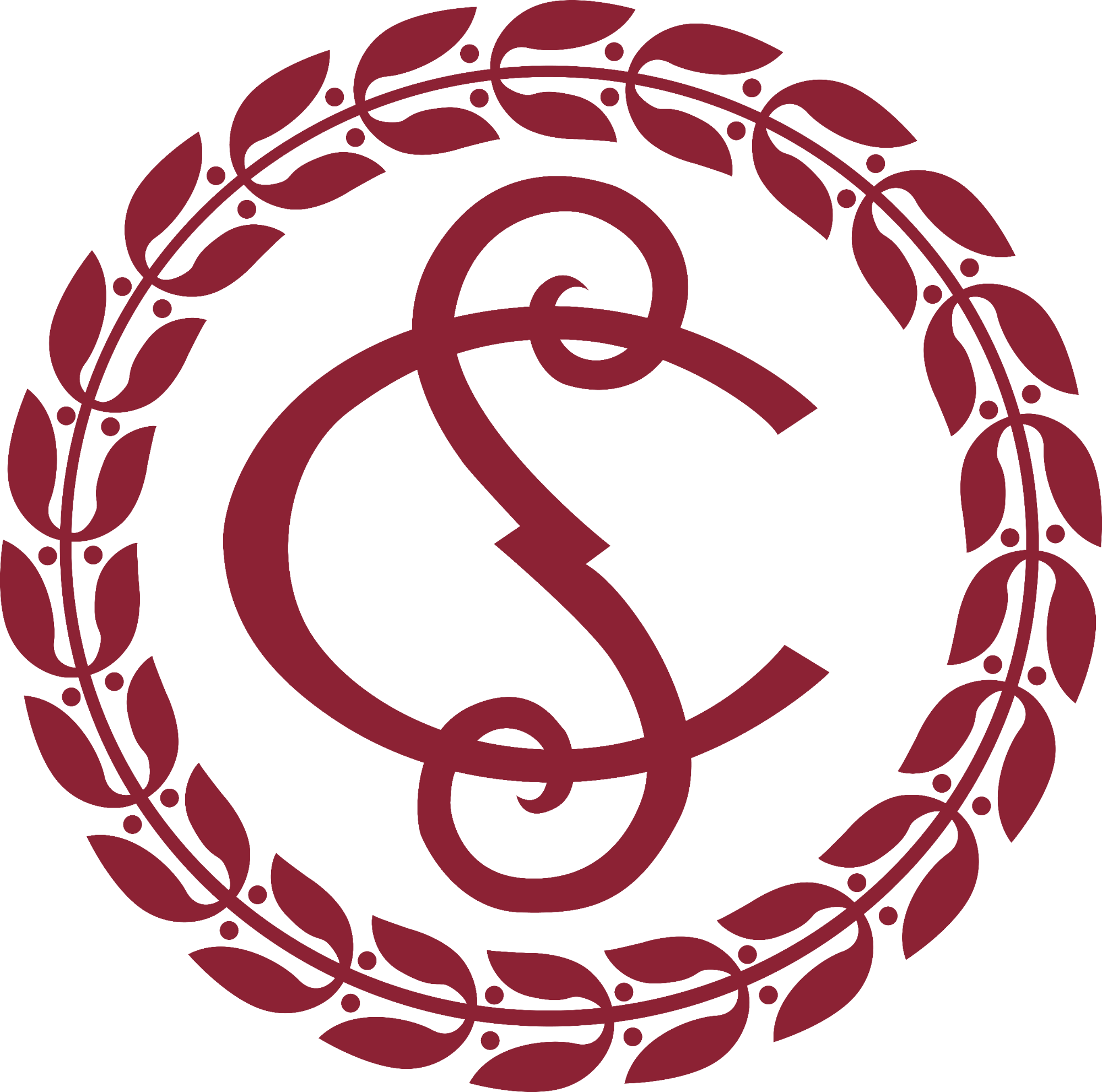La Cause en bref
Les Causes en bref sont des courts résumés en langage simple des décisions rendues par écrit par la Cour. Ils sont préparés par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.

Kosoian c. Société de transport de Montréal
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 29 novembre 2019
- Citation neutre : 2019 CSC 59
- Décompte de la décision :
- En appel de la Cour d’appel du Québec
- Renseignement sur le dossier (38012)
- Diffusion Web de l'audience (38012)
- Décisions des tribunaux inférieurs :
Sommaire de la Cause
Les policiers n’étaient pas autorisés à arrêter une personne parce qu’elle n’avait pas tenu la main courante d’un escalier mécanique, juge la Cour suprême.
En 2009, madame Kosoian entre dans une station de métro afin de se rendre au centre-ville de Montréal. Près de l’escalier mécanique, il y a une affiche sur laquelle figurent les mots « attention » et « tenir la main courante » et un pictogramme (un dessin) montrant une personne tenant la main courante. Alors qu’elle descend dans l’escalier mécanique, madame Kosoian fouille dans son sac afin d’y trouver de l’argent pour acheter son billet. Pendant qu’elle fait cela, elle ne tient pas la main courante. L’agent Camacho la voit et lui dit de tenir la main courante. Elle ne le fait pas, car elle n’estime pas être obligée de le faire. Lorsqu’elle arrive au bas de l’escalier mécanique, l’agent Camacho l’empêche de poursuivre son chemin. Il lui demande de le suivre jusqu’à un local de confinement afin de pouvoir lui remettre un constat d’infraction en raison de sa conduite. Elle refuse de le suivre, parce qu’elle ne croit pas avoir fait quoi que ce soit de mal. L’agent Camacho et un autre agent l’empoignent et l’emmènent au local. Ils lui demandent de fournir une pièce d’identité. Elle répond non et demande à appeler un avocat.
L’agent Camacho dit à madame Kosoian qu’elle est en état d’arrestation. Les agents la menottent, les bras derrière le dos, et la forcent à s’asseoir sur une chaise. Ils fouillent son sac sans permission. Elle est agitée, mais se calme lorsque les policiers l’informent qu’il y a une caméra de surveillance dans la pièce. Ils lui remettent deux amendes totalisant plusieurs centaines de dollars : une amende pour avoir désobéi au pictogramme et une autre pour avoir empêché les agents de faire leur travail.
Le lendemain, le conjoint de madame Kosoian porte plainte auprès de la Société de transport de Montréal (STM), qui est responsable du métro. Il demande les bandes vidéo. La STM ne donne jamais suite à sa demande et les bandes sont automatiquement effacées après cinq jours. Madame Kosoian consulte un médecin qui lui dit qu’elle souffre de stress post-traumatique et d’une entorse au poignet en raison de ces événements. Elle est par la suite acquittée par la Cour municipale et n’a pas à payer les amendes pour les constats d’infraction qu’on lui a remis.
Estimant que son arrestation était illégale, madame Kosoian intente des poursuites. Elle prétend que l’agent Camacho, son employeur (la Ville de Laval) et la STM sont tous responsables.
Le juge du procès et les juges majoritaires de la Cour d’appel concluent que l’agent Camacho n’a pas commis de faute, compte tenu des informations dont il disposait et de la formation qu’il avait reçue. Ils jugent que l’arrestation n’était pas illégale et déclarent que c’est madame Kosoian qui a causé ses propres problèmes en refusant de coopérer.
La Cour suprême a unanimement exprimé son désaccord avec ces conclusions. Elle a jugé que le pictogramme constituait un avertissement, qu’il n’existait aucun texte de loi disant aux gens qu’ils devaient tenir la main courante. Madame Kosoian n’avait pas à obéir au pictogramme. L’agent Camacho a eu tort de l’empêcher de poursuivre son chemin et de la fouiller pour le motif qu’elle aurait enfreint une loi qui n’existait pas. La Ville de Laval est responsable en tant qu’employeur de celui-ci. La STM pour sa part a commis une faute en ne formant pas l’agent Camacho adéquatement.
La STM enseignait aux policiers que les pictogrammes dans les stations de métro décrivent des règles de droit. Mais certains ne sont que des avertissements. Les pictogrammes qui décrivent des règles de droit et auxquels il faut vraiment obéir comportent certains indices. Par exemple, il existe un pictogramme qui indique le montant de l’amende susceptible d’être infligée et qui est accompagné de l’image d’un maillet suggérant l’idée d’une cour de justice (même si les juges canadiens n’utilisent pas de maillets). Le pictogramme concernant la main courante ne comportait pas d’indices de ce genre. De toute manière, il n’existe aucun texte de loi provincial ou règlement municipal disant que les gens doivent tenir les mains courantes des escaliers mécaniques.
La Cour a indiqué que la formation donnée par la STM expliquait en partie pourquoi l’agent Camacho croyait que le fait de tenir la main courante constituait une règle imposée par la loi, et pourquoi il a agi comme il l’a fait. Mais les agents de police doivent quand même utiliser leur jugement. Avant d’empêcher madame Kosoian de poursuivre son chemin, l’agent Camacho aurait dû s’assurer qu’il disposait d’une justification juridique valable de le faire. Un policier raisonnable aurait dû savoir que les gens n’ont pas l’obligation de tenir les mains courantes. Ou à tout le moins avoir un doute à ce sujet. Les policiers ont le droit de présumer que les règles qu’on leur demande de faire respecter peuvent effectivement être appliquées. Ils n’ont pas le droit de présumer qu’une règle existe tout simplement parce qu’on leur dit qu’elle existe.
La Cour a déclaré que l’agent Camacho et la STM étaient responsables à parts égales de ce qui s’était produit. Même si madame Kosoian n’a pas agi d’une manière idéale, elle n’avait pas d’obligation légale de tenir la main courante. Cela signifie qu’elle n’avait pas à coopérer et qu’elle avait le droit de poursuivre son chemin. La Cour a jugé que Mme Kosoian devait recevoir 20 000 $ pour le préjudice qu’elle a subi.
Il s’agissait d’une affaire de responsabilité civile découlant de l’accomplissement de gestes fautifs. Dans une société libre et démocratique, les policiers ne peuvent priver une personne des libertés qui lui sont reconnues que dans les cas où la loi dit qu’ils peuvent le faire. Les policiers doivent connaître la loi et agir dans les limites de celle-ci.